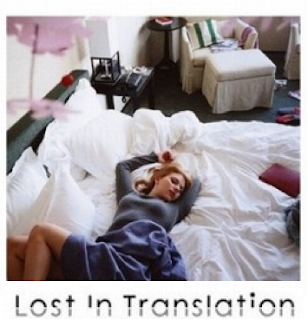En ce dimanche, la Cuillère est désolée. Vraiment désolée.
En ce dimanche, la Cuillère est désolée. Vraiment désolée.La Cuillère a cette semaine fait sa tournée des distractions culturelles, prête, comme toujours, à vous livrer son tropisme hebdomadaire, son coup de coeur, son point de vue.
Mais cette semaine, c'est compliqué, vraiment compliqué.
***
La Cuillère a souri devant le dernier Gondry. Juste souri.
Mais délirer sur des "super héros", ça se respecte tout de même.
Quoi encore? oui, elle a soupiré et zappé devant le cas Céline, blablabla, cela n'avait-il pas été tranché depuis longtemps? apparemment non.
La Cuillère a ri de façon alternative devant un Ivanov de Tchekhov dont le texte - génial - souffrait d'une mise en scène emphatique et lourde, mise en scène qui eut au moins le mérite de rappeler à ses oreilles d'aluminium l'autre grande mélodie de Barry Lyndon.
Non non, pas la Sarabande de Haendel, mais le Trio pour Piano et Cordes op. 100 de Schubert. Bouleversant.

La Cuillère a vu (et revu) avec bonheur (et bonheur) le mutin Banksy dont le docu-trompe-l'oeil croustillant n'a d'égal que cette sensation de lard, d'éléphant ou de cochon qui s'empare de vous à la sortie.
(What the f***?)
On a presque envie de se mettre à la bombe, mais l'on n'oublie pas la morale de l'histoire... c'est quand même pas fait pour tout le monde ces conneries là.
 La Cuillère a couru voir JR avant que les dernières sorties ne le boutent hors des salles.
La Cuillère a couru voir JR avant que les dernières sorties ne le boutent hors des salles.Alors oui, un coup d'oeil brillant sur le monde, mais un coup d'oeil dont l'esthétique tend à supplanter le fond, le sujet.
Un peu dommage quand même car c'est beau, c'est grave ; mais la forme contre le sens et au dessus du sens, le tout sur un registre monocorde, c'est dommage. Une oeuvre, une démarche sociétale et humaniste dont le documentaire rechigne à montrer la forme brute, pure, et belle... en imposant - justement - sa propre forme. Une forme sur une oeuvre sur une démarche humaniste, c'est beau, mais c'est (un peu) beaucoup.
 La Cuillère a passé une soirée délicieuse,, langoureuse, douce, amère et romantique avec Jane Campion et le jeune tourmenté Keats ; ça n'avait rien à voir, mais la Cuillère pensait beaucoup aux poètes malades et amoureux... Il fallait relire les Nuits de Musset, décidément.
La Cuillère a passé une soirée délicieuse,, langoureuse, douce, amère et romantique avec Jane Campion et le jeune tourmenté Keats ; ça n'avait rien à voir, mais la Cuillère pensait beaucoup aux poètes malades et amoureux... Il fallait relire les Nuits de Musset, décidément.La Cuillère a aussi attendu une amie Fourchette chez Gibert Jeune, empoignant dans le auvent réfrigéré le Marie-Antoinette de Zweig. Grignotant les quinze premières pages d'une prose délicieuse en deux coups de cuillère à pot, elle est allée se réchauffer en levant quelques pintes et en pensant très fort au billet à pondre dimanche (ce dimanche!)
***
Et donc désolée, vraiment désolée, mais la Cuillère en ce dimanche ne sait pas trop quoi vous dire, la semaine fut belle et riche, mais difficile d'en tirer quelque chose aujourd'hui.Alors à vous, pour une fois, de dire à la Cuillère ce qui vous a plu, ému, enchanté, bouleversé, fait rire ou sourire!
A vos claviers ! rendez-lui la semaine prochaine moins compliquée!
Bon dimanche chers lecteurs!