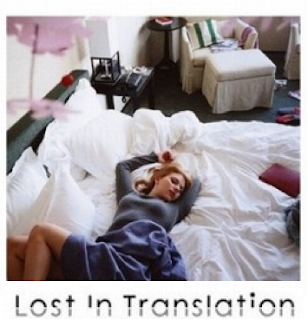Dans les forêts de Sibérie
Dans les forêts de SibérieC'est le genre de livre qu'on vous offre. Celui qui pavane aguicheur sur un étal, à portée de main, racoleur avec son joli cordon rouge, et l'adage de l'authenticité qui trône - à des fins commerciales - "connais toi toi même". Allons bon.
C'est le genre de livre à la fois fascinant, et agaçant. Fascinant par son sujet. Agaçant par sa composition, par son auteur, par ce style qui oscille de la simplicité ennuyeuse à l'envolée grandiloquente et ampoulée. Mais qui saurait rester insensible devant le courage de celui qui s'évade du monde pour retrouver le temps.
Dans les forêts de Sibérie, c'est le journal d'un homme qui s'est fait la promesse de reprendre la mesure de chaque seconde, et de ressentir chaque pulsation de sa vie, loin de tout, loin des hommes, des villes, du confort, au cœur des taïgas glacées qui jouxtent le Baïkal.
Six mois d'oubli à des milliers de kilomètres de chez soi. Pas loin de deux cents jours passés dans le silence, les livres, les tempêtes, la méditation, et - c'est vrai - les litres de vodka engloutis avec la facilité de l'enfant qui tète. Fascinante décision que celle de l'homme "moderne" qui se rêvait anachorète, et le devient.
 Agaçante cette vie, pour l'homme d'ici, dans son canapé, sa rame de métro, qui croit peut être lire London, et se retrouve devant un placebo de Thoreau. Car la valeur de ce livre ne nous parvient que dans les dernières pages, quand l'on sent soudain venir la fin, et que l'on comprend. Seulement maintenant.
Agaçante cette vie, pour l'homme d'ici, dans son canapé, sa rame de métro, qui croit peut être lire London, et se retrouve devant un placebo de Thoreau. Car la valeur de ce livre ne nous parvient que dans les dernières pages, quand l'on sent soudain venir la fin, et que l'on comprend. Seulement maintenant. Auparavant, ce ne sont que de longues descriptions méditatives de couleurs dansantes sur la neige qui susurre, de vents qui dévorent, de soleils qui dévalent, de montagnes qui enserrent et du lac qui fascine. Les lectures sont là, aussi enivrantes que les litres d'éthanol. Et dans le mordant blizard, ou la chaleur de la cabane défilent Sade, Hegel, Whitman, Chateaubriand, Jünger, Defoe, Déon et mille autres charmeurs de temps avec qui l'on blablate.
Entre la pensée taillée d'aphorismes gonflés par l'ivresse, parfois chiants comme la mort, et les développements du misanthrope bien-penseur donneur de leçons (mais qui - dans le fond - n'a pas si tort), de véritables pépites de bonheur, des capsules de rêves qui saisissent l'instant et vous laissent envieur, secoué.
On suit les jours identiques, et les mots qui défilent. Quelques visites de loubards des forêts, gardiens d'un autre temps, au cœur grand comme la Sibérie, aux manières taillées par les frimas. Des escapades. Des nuits qui recouvent. Encore du temps, toujours du temps. Précieux. Incommensurable.
Car s'il y a bien du bonheur dans ce livre, c'est à ce moment précis où l'on a dépassé l'agacement et que l'on embrasse avec allégresse chacun des instants passés dans ces forêts, ceux qui nous montrent la voie patiente, celle qui découpe dans le temps des éclats de paix, de félicité.